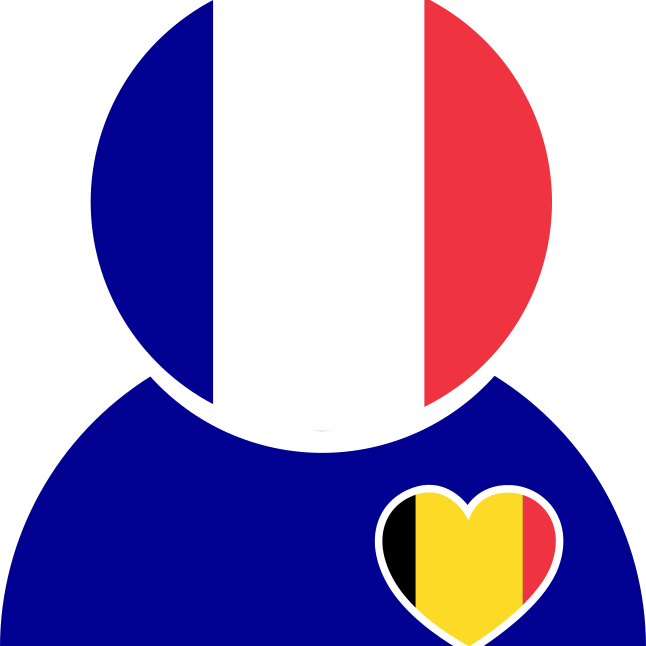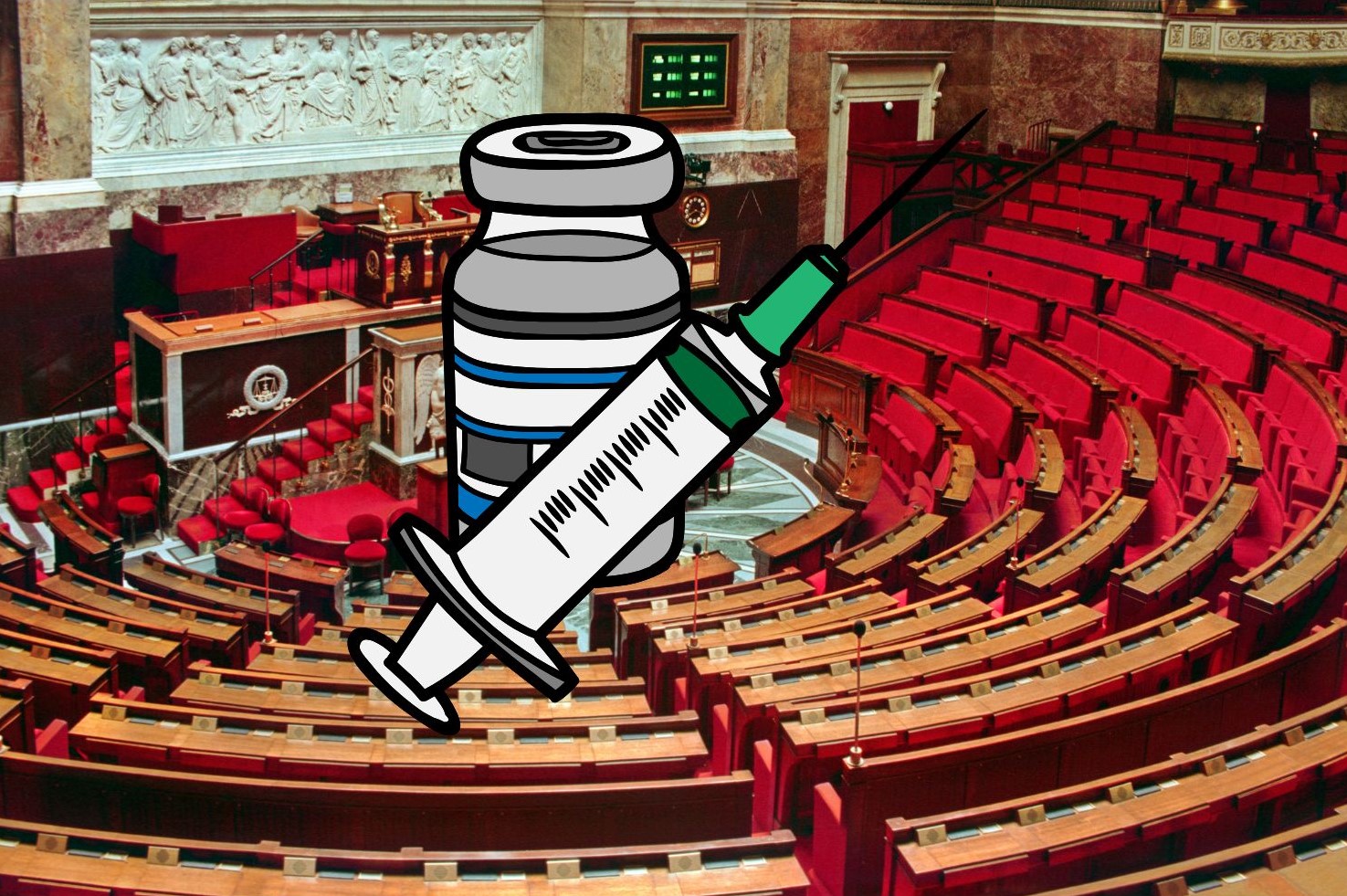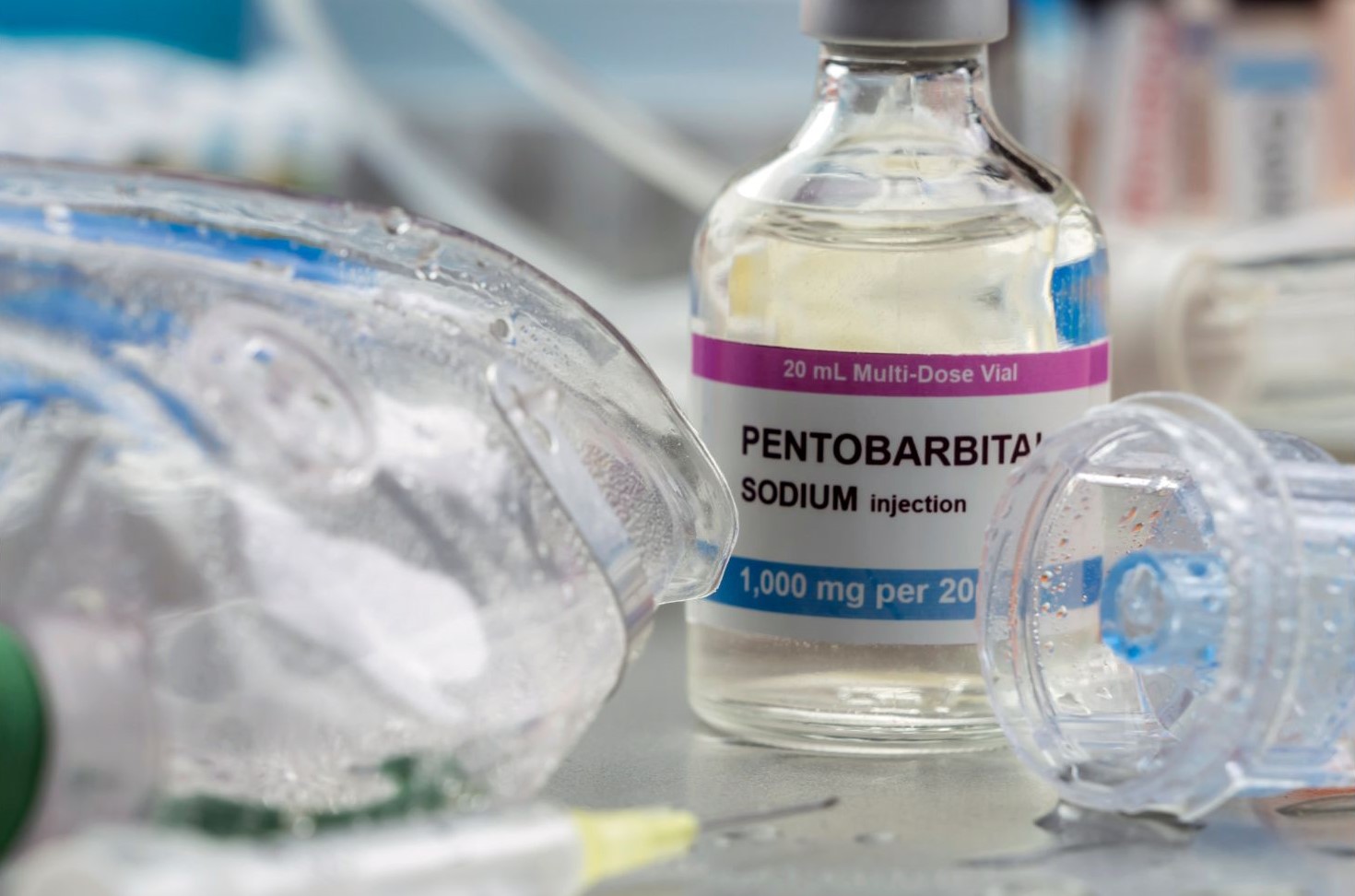Une alerte de la présidente de l’AFrESHEB, Isabelle Resplendino
Aujourd’hui, comme tant d’autres représentants de personnes en situation de handicap, (lire cet article : Handicap et euthanasie : la lutte pour la vie et cet article : Le vent de révolte antivalidiste contre l’aide à mourir) je suis très inquiète de cette proposition de loi française qui risque d’intégrer déjà bien des dérives amenées par l’extension de cette loi en Belgique.
Un procès sur l’aide à mourir a déchiré la Belgique
Extraits :
« C’est la famille qui a porté plainte en 2011, reprochant aux médecins d’avoir pris une décision hâtive et précipitée. D’autant plus qu’un diagnostic d’autisme venait tout juste d’être rendu en ce qui concerne Tine Nys. Deux mois plus tard, la patiente mourra pourtant sans même avoir été traitée pour cette maladie, a notamment soutenu devant les jurés la soeur de Tine, Sophie Nys. […]
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a eu beau resserrer ses directives déontologiques en 2019, selon Carine Brochier de l’Institut européen de bioéthique, « la loi est devenue incontrôlable. On a commencé par les patients en phase terminale. On l’a ensuite élargie aux personnes âgées souffrant de plusieurs pathologies ».
« Ensuite aux personnes menacées de démence, puisqu’une fois la démence en place, l’application de la loi n’est plus possible. Enfin, à la détresse psychologique. On ne s’est pas rendu compte de ce qu’on faisait. »
Selon le rapport de la Commission belge de l’euthanasie, en 2017, cinq personnes ont été euthanasiées sur la base d’un trouble autistique défini comme incurable, rapporte l’hebdomadaire Le Vif Express.
Pour information, les médecins ont été acquittés.
Euthanasie pour des jumeaux belges sourds de 45 ans
Des frères jumeaux belges, nés sourds et en passe de devenir aveugles, avaient obtenu le droit de mourir.
C’est sûr que cela revient bien moins cher que de leur apporter l’aide nécessaire à compenser les handicaps…
Et, même avant cette loi, le vécu des familles
Quand un enfant polyhandicapé présente une détresse respiratoire, le médecin qui demande si « ça vaut la peine de le réanimer » (pourquoi ? il coûte trop à la société ?).
Au Québec, on y pense déjà
Luc Ferrandez propose d’euthanasier des personnes handicapées : L’animateur du 98,5 FM et ex-maire, a affirmé sur les ondes que la mort de personnes vivant avec un handicap sévère serait une solution au système public surchargé. Cette déclaration a fait réagir les organismes de défense de droit et semé l’inquiétude chez les personnes handicapées, dans un contexte de coupures dans les services de soins à domicile. Sa co-animatrice est une ex-vice-première ministre. Lire l’article.
Un risque à ne pas écarter
Dois-je rappeler ces concepts fumeux de psychanalystes expliquant qu’ils avaient eu, pendant une séance de packing, une communication « d’inconscient à inconscient » avec leur « patient » et pu retranscrire ainsi leur pensée et leur désir ??? Si les psychiatres/psychologues de cette obédience prétendent qu’un enfant en situation de handicap et non verbal a exprimé une demande de mourir, quel outil de pression supplémentaire sur la famille, mieux qu’un signalement abusif !
Mais bon, se débarrasser des personnes en situation de handicap, cela génèrera des économies pour l’État, plus besoin de places, plus besoin de les envoyer à l’Étranger, plus de procès coûteux…
Pour l’État qui pourra continuer à dépenser son argent pour ses pantouflards dorés, les copains du CAC40, Zelensky et tout un tas de causes trèèèèèès utiles comme les millions envoyés à la Chine pour l’écologie.