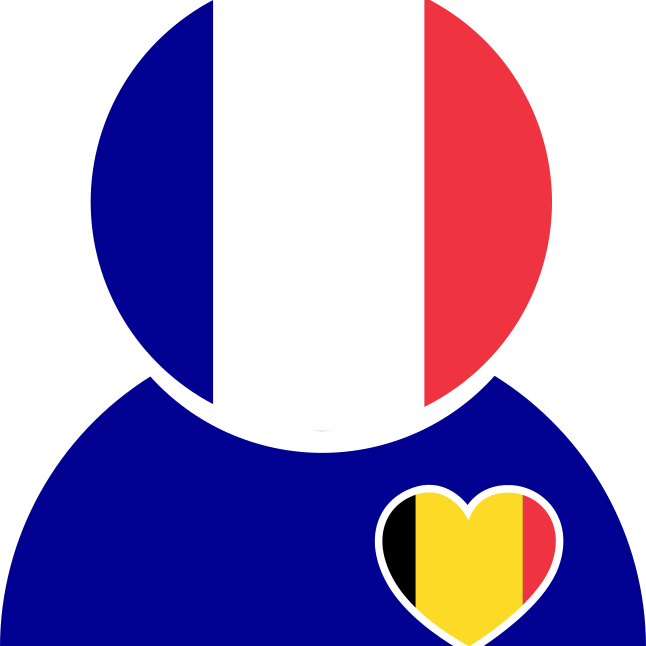Débat à la radio sur le manque de solutions adaptées en France pour les enfants et adolescents autistes.
La question du jour (émission « Questions du soir ») était : « Les jeunes autistes sont-ils bien pris en charge en France ?
Avec : Eric Jeanrenaud, directeur d’un IME français (La Chamade, de l’association HAARP), et Isabelle Resplendino, Présidente de l’Association pour les Français en situation de handicap en Belgique.
Le mot de la fin a été pour Eric Jeanrenaud, Il a déclaré que l’autisme était une psychose, et que nous (autrement dit, tous ceux qui n’avaient pas une psychose) étaient des névrosés.
Il est encore sidérant de constater l’entrisme de la psychanalyse en France, malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Venant d’une radio publique dépendant de Radio France, comme France Inter qui avait offert cet été une tribune à la psychanalyste Caroline Goldman affirmant que le trouble de l’attention avec hyperactivité n’existait pas, cela ne m’a cependant pas étonnée.
Je n’ai pas pu répliquer à M. Jeanrenaud qui disait que maintenant on ne culpabilisait plus les mères pour l’autisme, alors que, dans le secret des cabinets de psychanalystes, cela se passe encore quotidiennement. Ou que les professionnels de l’éducation nationale / de l’aide sociale à l’enfance accusent les mères de syndrome de Münchhausen par procuration, niant les diagnostics officiels de l’autisme.
Ni non plus sur son affirmation comme quoi les établissements belges étaient payés par la France (et que c’était une manne financière pour eux).
Premièrement, les écoles spécialisées et les internats scolaires spécialisés ne reçoivent pas un seul euro de la France.
Deuxièmement, les établissements médico-sociaux conventionnés avec la France qui sont donc financés par la sécurité sociale française (ou les départements) sont bien moins payés que les établissements français (environ 20% de moins), alors qu’ils accueillent une population bien plus durement touchée, dont les établissements gestionnaires français, mis à part quelques rares idéalistes, ne veulent pas et sont bien contents de s’en « débarrasser » (le mot est fort mais reflète la réalité) en Belgique.
Pour écouter le débat, c’est par ici.